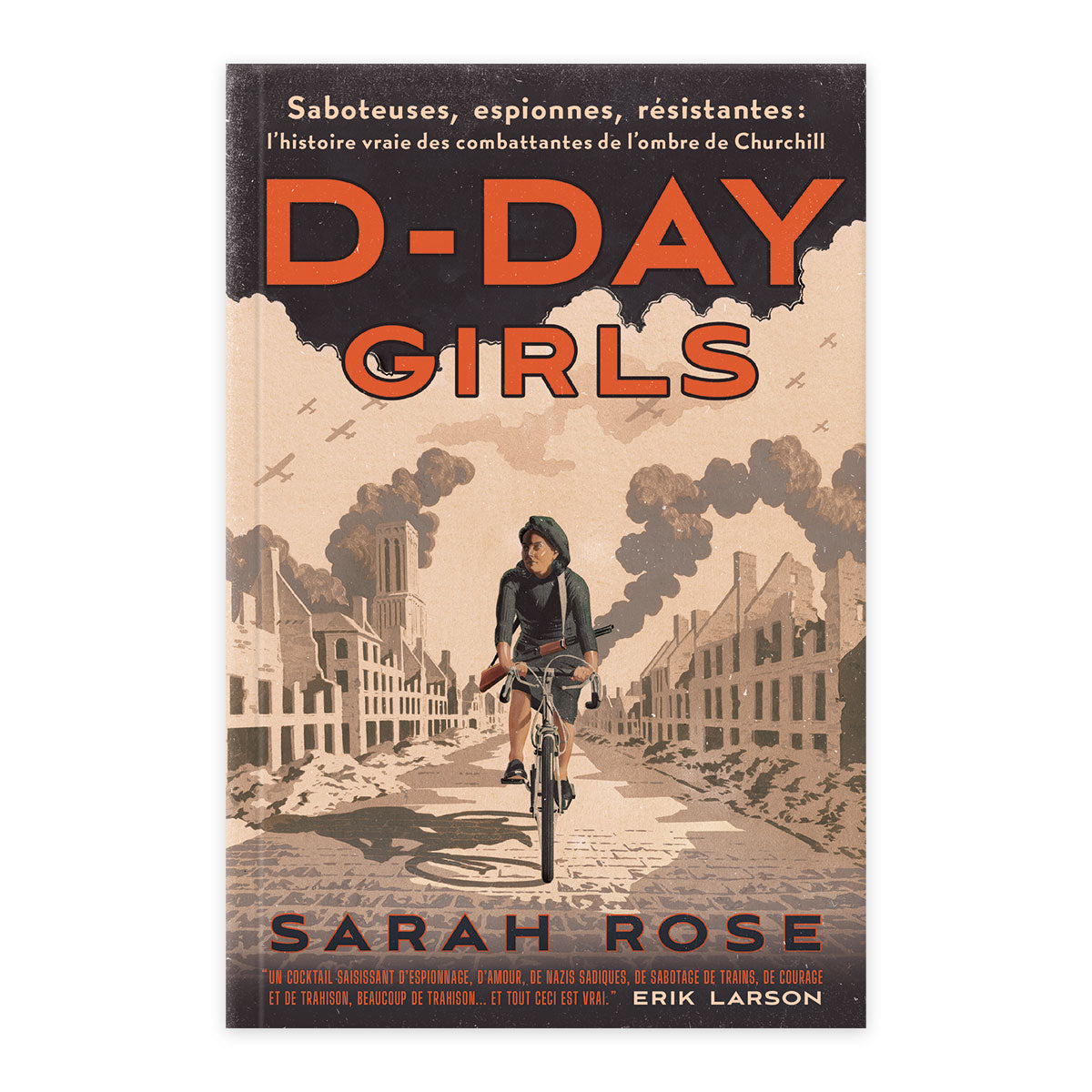Extrait de D-Day Girls
CHAPITRE 1
Que Dieu nous vienne en aide
Londres
Sous le regard éternel de l’amiral Lord Nelson, haut perché sur sa colonne de pierre au centre de Londres, Odette Sansom courait vers son rendez-vous au War Office, le ministère britannique de la Guerre. Le héros borgne et manchot de Trafalgar était battu par la pluie, mémorial de bronze à la gloire de la Pax Britannica, bien loin du conflit sanglant qui secouait Londres ce 10 juillet 1942.
C’était le 1 043e jour de la pire guerre que le monde ait connu.
Une grande partie de la ville était en ruines, les maisons effondrées à intervalles réguliers dessinant le sourire d’un enfant qui aurait perdu des dents. Odette inclina son chapeau pour se protéger du crachin et pressa le pas devant les lions de cuivre de l’amiral, dans un élan qui était le dernier recours de l’Angleterre pour retrouver le sourire.
Lorsqu’ils rencontraient Odette, les Londoniens se heurtaient à son impétuosité gauloise, à son caractère irrémédiablement français. Elle était plus jolie que ses contemporaines anglaises, et elle en était consciente : de grands yeux châtains, un « teint frais » encadré par des cheveux foncés remontés au-dessus d’un visage en forme de cœur et retombant négligemment sur la nuque. Son manteau clair, fermé par une ceinture, apportait un éclat de couleur dans la monotonie fade et pluvieuse du paysage londonien ; la ville était pleine d’uniformes — soldats, marins, aviateurs. Le monde entier était devenu terne. Bien qu’elle eût vécu en Angleterre une grande partie de sa vie d’adulte, Odette ne s’était jamais débarrassée de son air continental, et ne s’en était jamais non plus souciée ; la réserve typiquement britannique semblait inadaptée à l’amour et aux femmes. Avec une théâtralité appuyée, Odette se pavanait et les hommes en kaki se pâmaient. On disait d’elle qu’elle souriait même en français.
L’hôtel Victoria était une grande dame sous naphtaline, réquisitionnée pour les besoins de la guerre en tant que siège administratif du War Office. Il n’y avait aucun groom pour accueillir Odette ; les lustres scintillants avaient été soigneusement remisés dans des abris ; le bâtiment n’était plus que triste et purement fonctionnel, comme tout le reste. Aucun dandy ne sortait son étui à cigarettes dans le hall de marbre rose ; il y avait toujours du monde, mais des préposés et des sergents, des hommes en civil qui restaient à l’écart du front, des vieux, des éclopés, des réformés, des trop utiles pour être sacrifiés. Il fallait bien que quelqu’un s’occupe de gérer cette guerre.
Odette était venue en réponse à une invitation dactylographiée — la deuxième qu’elle avait reçue du War Office :
Chère Madame,
On m’a communiqué votre nom en me suggérant que vous avez des qualifications et des informations qui pourraient être utiles à certains aspects de l’effort de guerre.
Si vous êtes disponible pour un entretien, je serais heureux de vous recevoir à l’adresse ci-dessus à 11 heures le vendredi 10 juillet.
Merci d’avance de me faire savoir si vous pouvez venir ou non.
Sincèrement,
Selwyn Jepson
Capitaine
Pour Odette, femme malheureuse en ménage, vivant sa troisième année de guerre, cette lettre sur papier à en-tête du gouvernement était pleine de promesses. Ce rendez-vous serait au moins l’occasion pour elle de passer un après-midi seule. Il y avait un nouveau film à Leicester Square, Madame Miniver, un vibrant hommage au comportement des femmes au foyer en Angleterre et à leur contribution à l’effort de guerre, à la façon dont les mères de famille déplaçaient des montagnes pendant que les hommes étaient au front. Il y avait du lèche-vitrine à faire, bien que, comme ailleurs en Europe, le rationnement et la maigre solde d’un mari sous les drapeaux ne permettaient guère d’acheter grand-chose. Au mieux, la lettre pourrait rebattre les cartes de la vie trop bien réglée d’Odette, car de quelles « qualifications et informations » l’armée pourrait-elle avoir besoin, si ce n’est de sa maîtrise de la langue française ? Le War Office recherchait peut-être des traducteurs. Ou des secrétaires. Elle n’était pas trop âgée pour taper à la machine, ou pour écrire des lettres aux prisonniers de guerre en France. Ce serait, à n’en pas douter, un emploi très utile.
Odette ne savait pas ce qu’on lui demanderait, et la lettre du capitaine n’en disait pas beaucoup plus. Si le War Office avait des besoins précis en tête, elle était déterminée à se rendre utile.
Odette vivait dans la campagne pluvieuse du Somerset. Âgée d’à peine trente ans, elle élevait seule ses trois filles de moins de six ans — Lily, Françoise et Marianne — tandis que son mari, Roy, était enrôlé dans la lutte contre Hitler. Roy était le fils du soldat anglais qui avait logé dans sa famille pendant la Grande Guerre, et elle l’avait épousé jeune — trop jeune —, à dix-huit ans, pratiquement un nourrisson elle-même, estimait-elle, tant elle était sotte et adolescente ; elle avait paniqué lors de sa nuit de noces et refusé de partir en lune de miel. À la place, elle avait emmené sa mère et sa belle-mère au cinéma.
La guerre avait marqué toute la jeune vie d’Odette. Elle n’avait que six ans lorsque son père fut tué à Verdun, quelques jours avant l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Son corps s’ajouta aux 300 000 tombés à cet endroit pendant la bataille du même nom, un gâchis honteux et douloureux. Les enfants de l’entre-deux-guerres grandirent dans une Europe blessée, dont les plaies des Flandres et de la Somme ne finissaient pas de saigner. La France fut indignée par la brutalité allemande ; l’Allemagne ressentit la même chose face aux réparations de guerre que ses voisins lui avaient imposées. Sans père, Odette avait été élevée dans la maison de ses grands-parents, ses dimanches se résumant à une litanie de visites dans les cimetières et de services religieux aux côtés de sa mère veuve. Comme tant de filles de la Grande Guerre, Odette avait été profondément transformée par le traumatisme ; il l’avait rendue à la fois douce et dure, vulnérable et féroce.
Adulte, mère de famille mariée mais seule en Angleterre, Odette fut chassée de l’agitation de la vie urbaine par le Blitz et contrainte de se réfugier dans les campagnes verdoyantes et désertes. En 1940 et 1941, les nuits londoniennes étaient déchirées par les bombes et illuminées par les projecteurs ; le ciel était un feu d’artifice quotidien de fusées éclairantes et de flammes. Si elle était restée, son bébé aurait été équipé d’un masque à gaz ; elle aurait appris à distinguer le bruit d’une mine parachutée de celui d’un canon antiaérien, dans le même temps qu’elle devenait bilingue français-anglais. Le Somerset était un endroit plus sain pour élever ses filles.
Les journées d’Odette s’égrenaient dans une suite interminable de rituels campagnards : faire la queue chez le boulanger, compter les tickets de rationnement et, lorsqu’il fut devenu impossible de se procurer du tissu, raccommoder les vêtements. Les affiches de propagande vantaient les vertus de l’épargne : « Je défends moi aussi la patrie — et les tickets de rationnement ne me causent pas de souci ! » Le message était si austère. « Passez en revue votre garde-robe. Portez vos vieux vêtements et réparez-les. » Odette s’habillait à la mode autrefois, elle était capable de pincer et de plisser n’importe quelle fripe pour la transformer en un bel ensemble grâce à ses talents de couturière, mais il n’y avait plus personne pour qui se faire belle, maintenant qu’elle était exilée à la campagne. « Des vêtements austères pour la quatrième année de guerre », s’exclamaient les hebdomadaires féminins ; on portait aux nues les vestes sans garniture et les « jupes vertueuses ». Odette aspirait à retrouver l’excitation londonienne, le plaisir d’être entourée d’amis et d’attirer l’attention. Cette vie au foyer rustique et monacale ne lui convenait pas. C’était un quotidien trop fade pour une femme aussi énergique.
Le capitaine Selwyn Jepson était assis à son bureau au War Office, pièce 055a — l’ancienne chambre 238 du Victoria Hotel, si petite qu’elle aurait pu être un placard à balais. Dépourvue de tout agrément au profit d’un utilitarisme sévère, la pièce ne contenait qu’une seule commodité : un lavabo. Il n’y avait pas de meubles à proprement parler, à l’exception d’une simple table en bois et de deux chaises. Cette sobriété était délibérée, ordre du capitaine, qui avait demandé que la salle d’entretien soit vidée de tout ce qui pouvait évoquer un caractère officiel ou confortable. Il n’était pas là pour bavarder ou pour se mettre à distance de ses visiteurs derrière un grand bureau. Il voulait que rien ne vienne entraver le principe de confiance : pas de séparation, pas de statut, pas de grade — sauf, bien sûr, s’il interrogeait un militaire, auquel cas il portait son uniforme par respect.
Le capitaine Jepson baissa les yeux sur le dossier qui se trouvait devant lui. Mme Sansom n’avait aucune ascendance apparente chez l’ennemi ; le gouvernement de Sa Majesté n’avait rien trouvé à redire : « Nothing Recorded Against », aucun élément à charge. Autrement dit, son dossier était vierge de tout soupçon. Scotland Yard et le MI5, le service de la sûreté, avaient apparemment décidé qu’elle était une candidate suffisamment acceptable pour être reçue en entretien. Cela ne lui suffisait pas pour autant, c’est certain. Il dénicherait toutes les objections, le cas échéant.
Prénoms : Odette Marie Céline
Nationalité : Britannique
Nationalité de naissance : Française
Lors de son mariage, Odette était devenue anglaise par le biais d’un concept juridique connu sous le nom de coverture, c’est-à-dire qu’elle avait été englobée dans le statut juridique de son mari ; elle était devenue une partie de lui, comme une main fait partie du corps.
Le dossier d’Odette avait été ouvert en raison de son désir d’aider à la lutte. En mars 1942, un appel urgent avait été lancé lors du journal du soir de la BBC : la marine souhaitait recevoir des photos des côtes françaises. Dans les émissions de 18 heures et de 21 heures, entre les Proms — une série de concerts — et les informations en norvégien, le présentateur expliquait que même les photos souvenirs qui semblaient présenter le moins d’intérêt pouvaient contribuer à l’effort de guerre. Des albums insignifiants et anodins pouvaient faire basculer la guerre en Europe, puis, une fois l’Europe libérée, dans le monde. Ce fut l’un des nombreux appels patriotiques lancés cette année-là ; le lendemain matin, les Britanniques y répondirent en envoyant quelque trente mille enveloppes contenant dix millions de photos de vacances.
Odette, elle aussi, répondit à l’appel. Elle fit don au gouvernement de ses photos de famille, une collection de clichés d’elle, jeune fille, sur les grandes plages de la baie de Somme, non loin de sa ville natale d’Amiens, de pique-niques et de parasols, de châteaux de sable et de cabanes de plage, de son frère, de sa mère, de ses grands-parents, et même d’un père qu’elle n’avait jamais connu, des souvenirs simples et ordinaires d’étés passés depuis longtemps.
Les moindres détails avaient leur importance dans la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Une officine top secret à Oxford était en train de dresser une carte détaillée du littoral français. Même si l’Angleterre disposait de nombreuses informations sur la France — cartes Michelin, guides Baedeker décrivant chaque village portuaire, et cartes marines avec indication des profondeurs —, l’Amirauté avait besoin de renseignements plus spécifiques. Pour préparer un débarquement, la marine devait obtenir une représentation du littoral vu à la hauteur des vagues, depuis la proue d’une péniche de débarquement. L’Inter-Services Topograhical Department (ISTD), la Direction topographique inter-services, était en train de constituer une vue d’ensemble des côtes de la France et des Pays-Bas. La marine devait savoir à quoi ressemblaient les ports et les plages, la pente de chaque dune, les virages de chaque route sinueuse, le tracé de chaque ruisseau, chaque élément du paysage susceptible de fournir des informations sur la distribution des eaux, les angles morts et les chemins d’approche. Aucun raid mené par un petit commando ni aucune campagne de photographie aérienne ne pouvait produire une telle carte ; le seul moyen d’obtenir une vue d’ensemble du terrain était d’en bricoler une à partir des souvenirs de vacances d’avant-guerre des Britanniques. Une équipe de chercheurs de la bibliothèque Bodléienne, la plus prestigieuse des bibliothèques de l’université d’Oxford, se penchait sur les albums ainsi reçus, prenant des photos de photos, puis rendait les albums à leurs propriétaires légitimes, qui ne surent jamais quelles images avaient été utilisées, ni même pourquoi. L’ISTD construisit une mosaïque de photos, un montage de souvenirs familiaux, et cousut le panorama en un gigantesque patchwork topographique. C’était la plate-forme de départ d’un plan de bataille pour la reconquête de l’Europe par les Alliés. L’Angleterre était en guerre, et son champ de bataille se situerait en France.
Les photographies d’Odette n’avaient aucune valeur militaire. Les photos de son enfance ne furent même pas envoyées à la bibliothèque chargée de la guerre maritime. Après avoir entendu l’appel de la BBC, Odette avait envoyé ses photos au War Office, et non à l’Amirauté ; l’anglais n’était pas sa langue natale et elle n’avait pas saisi la différence. Elle n’avait pas envoyé ses quelques photos de famille au bon service.
Les rouages de l’administration militaire se mirent néanmoins en marche. Les vaguemestres transmirent son message de proposition de services à un bureau central, qui achemina l’information par des voies aussi appropriées qu’opaques jusqu’au capitaine Jepson.
Lorsqu’Odette entra dans le bureau du capitaine, il se leva pour l’accueillir selon les usages de politesse. Les fenêtres étaient encadrées par de lourds rideaux anti-aériens, ce qui rendait la pièce encore plus étroite ; la lumière était crue et électrique.
En costume sombre, le capitaine Jepson avait un visage espiègle et la voix aiguë d’un adolescent malgré ses quarante-deux ans. En temps de paix, il était journaliste et auteur de romans policiers bon marché ; en temps de guerre, il s’accrochait de tout son cynisme aux représentations mentales de son esprit lugubre. Ses yeux sombres, ses cheveux noirs et lisses et son caractère méfiant lui donnaient l’air d’être éternellement constipé.
Le capitaine, avec un accent affiné à la St Paul’s School où se côtoyaient tous les héritiers de grandes familles et les aristocrates, commença l’entretien par la question qu’il posait à tous ceux qui entraient dans son bureau : que pensait Odette des Allemands ?
Elle vouait une haine farouche à Hitler.
Elle détestait ce qui se passait en France. Sa mère avait été chassée de sa maison ; son frère avait été gravement blessé lors du blitzkrieg et était en convalescence à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, dans la ville de Paris occupée, dit-elle. Son pays avait subi un viol.
Elle pensait bien être capable de trouver un peu de pitié pour le peuple allemand, mais elle n’éprouvait rien de tel pour les occupants militaires.
Le capitaine avait compris que l’hostilité héréditaire des Français envers les Allemands n’avait d’égale que l’inimitié des Gaulois envers les Anglais. À ce moment de la guerre, il appartenait à Jepson, comme l’indiquait sa lettre, de sélectionner dans le creuset restreint mais crucial de ceux qu’il considérait comme des citoyens britanniques normaux, communs, moyens, quelques candidats de choix qui parlaient un français impeccable, qui pouvaient se comporter comme des Français et qui étaient, tout bien considéré, passablement français.
« Vous n’avez aucune idée de la manière dont nous nous y prenons », commença le capitaine, avec le dossier d’Odette sur la table devant lui. « Nous avons enquêté sur vous, ici même comme en France, et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons trouvé. »
Odette savait naturellement adopter un comportement très théâtral, c’était chez elle comme une seconde nature. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, son attitude passa de la modestie et de la coquetterie à l’indignation et à l’emportement le plus total.
« Qu’est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi avez-vous enquêté sur moi ? »
Dans l’Angleterre en guerre, Odette était suspecte du seul fait de sa naissance. La Grande-Bretagne éprouvait une forme de ressentiment : les mangeurs de grenouilles s’étaient rendus trop rapidement en 1940, l’armée française s’était effondrée face à l’avancée des panzers, la ligne Maginot s’était avérée n’être rien de plus qu’une vaste blague, les navires de guerre français en Afrique du Nord avaient été neutralisés à Alexandrie, les usines françaises fabriquaient des armes pour alimenter une machine de guerre nazie qui tuait des Anglais en Égypte.
La fidélité d’Odette pour son pays pourrait devenir un élément critique dans la lutte pour l’Europe. Le capitaine recrutait des soldats clandestins pour une guerre secrète en territoire contrôlé par les Allemands, mais les femmes comme Odette n’étaient anglaises que par mariage ; les épouses de Britanniques nées à l’étranger étaient facilement considérées comme des étrangères, des ennemies.
Elle rejeta l’insinuation avec suffisamment de véhémence pour rejouer la bataille d’Hastings. Dans un accès de colère, Odette récita sa profession de foi patriotique : elle avait trois filles anglaises qu’elle aimait de l’amour d’une mère et elle était fidèle à un époux britannique parti défendre le roi et le pays comme soldat. Elle menait une vie paisible, et ne faisait rien qui puisse verser dans des accusations de trahison ou d’illégalité. Odette était une Anglaise aussi convenable que n’importe quelle fille née en Grande-Bretagne.
« Pour qui me prenez-vous ? »
À ce moment-là, le capitaine prit sa décision : il acceptait de risquer la vie d’Odette.
Sans préciser les détails du poste pour lequel il recrutait, ni même le nom de son employeur, le capitaine Jepson proposa à Odette de se rendre en France pour le compte du gouvernement de Sa Majesté, contre trois cents livres par an. Se porterait-elle volontaire ?
« Attendez une minute. » Le capitaine marqua une pause. « Quelles sont vos obligations familiales ? »
Les moindres détails de la vie d’Odette étaient consignés dans le dossier qu’il avait devant lui, et il ne voulait pas envoyer à la guerre une femme qui pourrait se languir de ses bébés restés en Angleterre. Ses chances de revenir vivante n’étaient pas supérieures à une sur deux, voire moins.
Il sembla au capitaine qu’elle ne se préoccupa guère de ses filles ; « Oh, cela ne les dérangera pas », telle fut la réponse dont il se souviendrait.
Odette était en réalité plongée dans ses pensées. Elle formulait le problème posé par cette offre d’emploi nébuleuse avec le bon sens d’une mère de famille. Dois-je accepter le sacrifice que d’autres font sans sourciller ? se demandait-elle. Qu’adviendrait-il de ses filles si l’Angleterre, à son tour, se rendait à Hitler comme la France ? Elle pourrait s’avérer ne pas être utile à ce petit homme, Jepson ; elle pourrait s’avérer ne pas avoir les qualités requises pour le service. Mais elle était déterminée à au moins essayer, au nom de Lily, Françoise et Marianne.
N’ayant qu’une vague idée de ce que ce travail impliquait, Odette dit : « Envoyez-moi en formation. »
Le capitaine se leva et raccompagna Odette le temps d’accomplir les deux pas qui les séparaient de la porte, où ils se serrèrent la main. Elle avait une personnalité très forte et ne serait peut-être pas disposée à suivre les ordres, elle était trop forte tête. Elle remplissait néanmoins toutes les conditions requises : elle parlait couramment le français et possédait la nationalité britannique. Les Alliés avaient besoin de femmes comme Odette, un besoin qui allait changer le monde.
Il retourna au dossier sur sa table et griffonna une note rapide dans la marge, l’évaluation professionnelle de sa nouvelle recrue :
Que Dieu vienne en aide aux Allemands si jamais nous parvenons à la leur envoyer. Mais souhaitons peut-être aussi que Dieu nous vienne en aide en cours de route.
★★★
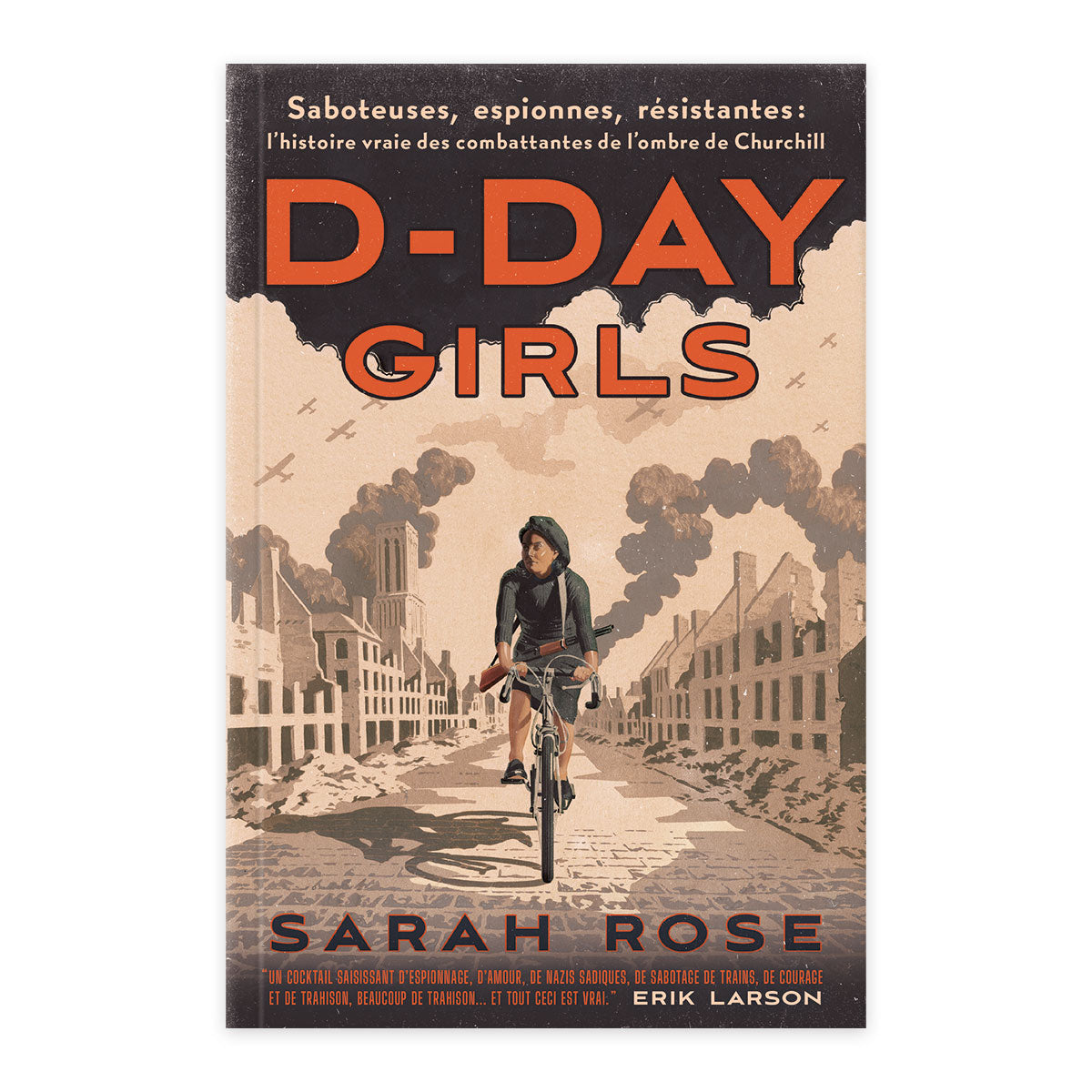
Sarah Rose
D-Day Girls
Saboteuses, espionnes, résistantes: l’histoire vraie des combattantes de l'ombre de Churchill